 Philippe Meirieu s’entretient avec Michel Briand : « Un itinéraire dans et pour la coopération » (1)
Philippe Meirieu s’entretient avec Michel Briand : « Un itinéraire dans et pour la coopération » (1)
(1) « La coopération, un processus qui requiert à chaque instant l’implication de chacun et de tous. »
Cet entretien est aussi publié sur le blog de Philippe Meirieu
Première partie : la coopération en héritage de l’Education nouvelle et du « Collège coopératif », vers la coopération dans les « groupes d’apprentissage ».
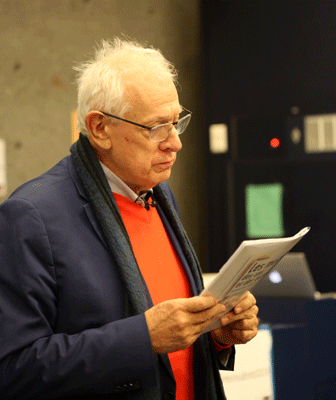
Bonjour Philippe Meirieu est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ?
Philippe Meirieu : Je suis actuellement professeur émérite en sciences de l’éducation à l’université LUMIERE-Lyon II. J’ai été toute ma vie enseignant, en collège, en lycée, à l’école primaire, à l’université. J’ai, très tôt, été un militant de ce que l’on appelle l’Education nouvelle [1], très proche, en particulier, de Célestin Freinet. Je me suis engagé aussi à différents moments de ma vie dans l’action politique, que ce soit une action au sein de l’Education nationale en acceptant des missions sur la formation des enseignants ou sur les lycées ou au sein du conseil régional Rhône Alpes en prenant la responsabilité de la Formation tout au long de la vie, avec une priorité envers les personnes en chômage de longue durée et les jeunes « invisibles ».
Et sur le champ de la coopération si tu avais à te présenter en quelques mots clés quels seraient-ils ?
Je m’inscris dans un double héritage, celui d’un pédagogue historique, Célestin Freinet, que je citais tout à l’heure et qui avait fait de la coopération le cœur de sa pédagogie, et celle d’un homme, Henri Desroches, dont j’ai rencontré la pensée en m’engageant au sein d’une structure lyonnaise qu’il avait fondée : le Collège coopératif [2].
Henri Desroches est une personnalité, à mes yeux, tout à fait exceptionnelle : philosophe sociologue, c’est aussi celui qui va construire autour de Marcel Barbu et de Boismondau [3] à Valence cette mémoire historique de la coopération, comme une alternative à la fois au tout État et au tout marché, tant sur le plan institutionnel que sur le plan économique. Sur le plan de la recherche et du travail intellectuel, il me semble qu’Henri Desroches a ouvert des voies absolument essentielles. D’une part en promouvant la possibilité pour un certain nombre de gens d’accéder à des diplômes universitaires à travers une mise en forme de leur expérience, ce qui à l’époque était tout à fait révolutionnaire et qui reste encore aujourd’hui encore assez marginal. Et, d’autre part, grâce aux méthodes qu’il a mises en place pour permettre à ces acteurs sociaux de s’engager dans la recherche, des méthodes coopératives au meilleur sens du terme, des méthodes grâce auxquelles celles et ceux qui avaient une expérience, militante dans l’immense majorité des cas, pouvaient prendre de la distance, réfléchir, se mettre à élaborer une théorie de leur propre pratique se mettre aussi, à partir de là, à faire des propositions pour le champ social.
J’ai eu la chance de pouvoir intervenir de nombreuses années auprès de ces personnes au sein du Collège coopératif dans cette tradition extraordinaire de promotion sociale et de promotion humaine individuelle et collective et de découvrir l’extraordinaire fécondité de ce que Henri Desroches appelait la « recherche-action collective », c’est-à-dire une recherche action dans laquelle il y a une forme de solidarité exigeante qui se substitue à la distance épistémologique du « savant » en extériorité.
Pour expliquer cela brièvement, je dirais volontiers que, dans l’université traditionnelle, ce qui garantit l’ « objectivité » c’est la non implication du chercheur dans l’action qu’il observe. On considère que, si un acteur est impliqué dans l’action, il n’est pas objectif puisqu’il est à la fois juge et partie. Dans la recherche-action telle que l’a proposée Henri Desroches, on considère qu’au contraire cette implication à la fois comme chercheur et comme praticien est un atout qui peut être constructif, positif, dès lors que cela s’effectue dans la coopération. L’exigence n’est plus liée alors à la distance de l’extériorité, mais elle est la manifestation de la solidarité entre des personnes qui sont impliquées dans une aventure commune et qui, au nom de leur engagement commun, ne sont jamais dans la complaisance les unes envers les autres, mais au contraire dans une exigence intellectuelle réciproque très forte. On remplace, et cela me paraît très important, la distance épistémologique traditionnelle que l’on voyait dans l’extériorité du chercheur par rapport à son objet, par la distance intérieure au collectif solidaire qui transforme sa solidarité en exigence : « parce que je suis solidaire avec toi, je vais être exigeant par rapport à ce que tu dis et tu vas être exigeant par rapport à ce que je dis ». Cette exigence, je vais l’intérioriser et je vais progresser dans ma compréhension des choses d’une manière tout à fait efficace, non pas parce que je suis, ou tu es, extérieur à mon combat mais parce que tu es solidaire avec moi et que nous sommes ensemble d’accord pour aller le plus loin possible afin que cette solidarité nous aide à améliorer notre regard, à améliorer notre conscience des choses et à décider ensemble ce qui sera le plus pertinent pour avancer.
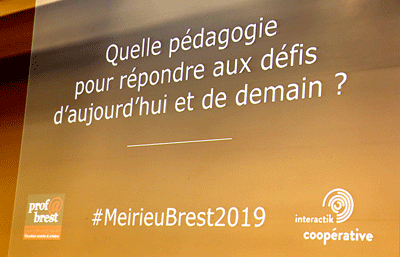

Conférence (vidéo ici) à l’invitation de la coopérative pédagogique 29 et du réseau coopératif Prof@brest à Brest le 29 janvier.
Dans la société, la coopération est assez peu pratiquée à l’école ou ou assez peu valorisée dans la vie sociale, dans les entreprises ; qu’est-ce qui a fait que, dans ton parcours, dans ton expérience, tu t’es impliqué dans la coopération ?
Après avoir rencontré les travaux de Célestin Freinet et Henri Desroches, j’ai été enseignant. J’étais militant de l’Education nouvelle et j’ai voulu mettre en œuvre les principes que j’avais hérités, les principes de la coopération avec mes élèves. Je me suis aperçu alors que ce n’était pas du tout évident, pas du tout simple et que ce que l’on appelait d’une manière générique et un peu vague « le travail de groupe » n’engendrait pas automatiquement une coopération efficace pour les membres de ce groupe. Comme je l’évoquais hier lors de la conférence [4], j’ai étudié et observé des centaines de groupes d’élèves au travail, j’ai regardé comment cela se passait. Je me suis aperçu que l’espoir qui avait été mis par un certain nombre de pédagogues et même par de grands psychologues comme Jean Piaget, sur ce qu’ils appelaient « l’interaction cognitive entre pairs », n’était pas toujours réalisé : la coopération n’était pas toujours au rendez-vous. En particulier j’ai observé que, très vite, sans régulation, sans préparation, sans travail d’accompagnement, la coopération se réduisait à une division du travail entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs.
J’ai rédigé ce qu’on appelait à l’époque une « Thèse d’État » sur cette question du travail de groupe et de l’interaction sociale et cognitive entre pairs. Je me suis inspiré des travaux de Willem Doise, d’Anne-Nelly Perret-Clermont, et d’un certain nombre d’autres psycho-sociologues cognitivistes qui, après Piaget, avaient travaillé sur le conflit socio-cognitif. Le conflit socio-cognitif c’est ce qui se passe « dans la tête de quelqu’un » au moment où il progresse, où il avance, où il accède à un niveau supérieur de compréhension. Mais le conflit socio-cognitif on est souvent tenté de l’éviter : ainsi, quand je rencontre quelqu’un qui me donne un conseil, je peux soit délégitimer sa parole et, à ce moment-là, j’estime que je n’ai pas à la prendre en compte... soit totémiser sa parole et, à ce moment-là, y adhérer de manière aveugle. Mais je peux aussi entendre ce que me dit l’autre en me demandant ce que cela m’apporte et en quoi cela interagit avec ce que je sais déjà, avec ce que j’ai vécu, ce que j’ai déjà compris, et cette troisième hypothèse est celle qui me fait réellement progresser. Car, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe : cela bouge, cela se déplace, il y a un conflit socio-cognitif et c’est à ce moment-là que l’interpersonnel devient de l’intrapersonnel que le sujet et le collectif interagissent vraiment.
Alors, je me suis dit : si la coopération doit avoir des effets pédagogiques, il faut qu’elle soit construite autour de ce schéma du conflit socio-cognitif. Il faut construire un modèle du travail collectif de telle manière que chacun soit à la fois capable de s’intégrer dans le groupe, de recevoir du groupe et de donner au groupe. Et donc à partir de là, j’ai élaboré ce que j’ai appelé le « groupe d’apprentissage ». Dans mon esprit, il doit être précédé d’un travail individuel ou bien de la vérification que chacun est bien en mesure de participer au groupe. Pour cela, il y a un certain nombre de prérequis que j’ai essayé d’identifier. Il y a les prérequis fonctionnels d’abord : capacité de verbaliser, par exemple, ou de s’impliquer physiquement et mentalement si la tâche collective le requiert. Il y a aussi des prérequis structurels ; certaines activités demandent des connaissances préalables précises et il est illusoire de demander à des personnes de s’y engager sans prévoir un moyen pour qu’elles les acquièrent en amont ou en cours de l’activité. J’ai souvent décrit, à ce moment-là, la coopération comme une sorte de puzzle. Un puzzle se construit parce que l’on a besoin de chaque pièce, il ne peut pas être fini si chaque pièce n’est pas impliquée dans la figure finale.
C’est pourquoi j’ai présenté la coopération, dans les modèles que j’ai proposés, comme une forme de construction collective où chacun va progresser, grâce à tous et faire progresser tous grâce à lui. Je me suis efforcé de construire cela concrètement et d’en proposer des mises en œuvre pour tous les niveaux d’enseignement. Je l’ai expérimentée avec de jeunes enfants pour la construction collective de récits ; je l’ai travaillée dans le secondaire pour la construction des concepts ; je l’ai mise en œuvre dans mes enseignements universitaires en promouvant des groupes de lecture des œuvres ou de travail sur l’écriture collective : je l’ai utilisée dans la formation d’adultes de bas niveau en organisant des échanges d’expériences et leur formalisation ; je l’ai utilisée dans la formation des enseignants en faisant bâtir des projets interdisciplinaires… et, chaque fois, il m’a semblé que, dès lors que l’on construisait la formation sur ces bases, on pouvait avancer considérablement. [5]
Et, depuis, ces travaux ont été prolongés par un certain nombre de collègues. Je pense, en particulier, à mon collègue Sylvain Connac, à Montpellier, qui a beaucoup travaillé sur cette question et qui montre comment les dispositifs coopératifs sont des dispositifs qui doivent être préparés, régulés, organisés - « didactisés » - pour que la « collaboration » ne dérive pas vers la division du travail, vers une fixation de places qui seraient définitivement allouées et affectées à chacun... mais, au contraire, pour qu’elle permette à chacun de se dépasser par et dans le collectif. Cette dialectique entre l’investissement de chacun et la contribution du projet collectif, est, pour moi, l’enjeu majeur de toute pédagogie de la coopération.
Je crois, d’ailleurs, que cette coopération, sous la forme que je viens de décrire, n’est jamais définitivement garantie et assurée, c’est-à-dire qu’à aucun moment on ne peut dire : « Là c’est fini, je n’ai plus rien à faire, les gens coopèrent et coopéreront toujours ». La coopération ce n’est pas une procédure qui serait algorithmique, que l’on pourrait fixer sous la forme d’un mode de fonctionnement définitif, c’est un processus qui impose et qui exige la vigilance d’un formateur ou d’un accompagnateur et, quand les gens peuvent se passer du formateur ou de l’accompagnateur, la vigilance de chacun et de chacune des participants. Il serait illusoire de croire que, parce que l’on a des « institutions coopératives » on a un fonctionnement coopératif. C’est un peu comme la démocratie, ce n’est pas parce que l’on a des institutions démocratiques que l’on a un fonctionnement réellement démocratique : les institutions sont nécessaires, mais pour qu’elles ne basculent pas dans le formalisme ou ne soient pas dévoyées, le processus doit être l’objet d’une attention permanente. C’est pourquoi ce qui me semble important aujourd’hui c’est, tout à la fois, de travailler sur des institutions qui permettent la coopération et de travailler sur le vecteur de la coopération, qui renvoie, lui, à l’implication de chacun dans le travail coopératif. Cela rend la problématique de la coopération à la fois fantastique et un peu compliquée parce qu’elle joue en permanence sur deux registres : le registre structurel - il faut organiser des structures coopératives - c’est ce que fait, par exemple, l’économie sociale et solidaire, c’est ce que font un certain nombre de structures coopératives, politiques ou pédagogiques – et, en même temps, au sein de ces structures, il faut accompagner en permanence la mobilisation des personnes dans la démarche coopérative. La coopération est inséparable d’une « pédagogie instituante du coopérer ». Car, on sait bien que les institutions coopératives peuvent se figer, elles peuvent déboucher sur une prise de pouvoir par certains au détriment d’autres ou bien une fuite dans un fonctionnement fusionnel sous l’emprise de gourous charismatiques. Lorsque les procédures coopératives ne sont pas irriguées par le processus coopératif, on aboutit à une sorte de rigidité fonctionnelle dont les effets peuvent même être, dans certains cas, mortifères.

échanges à la coopérative pédagogique 29 au lycée Vauban
Est-ce que tu pourrais présenter un projet ou une démarche coopérative à laquelle tu as participé ?

Image reprise du bandeaude la page du réseau d’échanges réciproque de savoirs d’evry
Quand j’enseignais en sciences de l’éducation à l’université LUMIERE-Lyon II, nous avions monté une « coopérative des apprentissages » qui s’appelait « Apprendre ». [6] C’était un projet dans lequel l’ensemble des enseignants, des étudiants mais aussi des praticiens de l’éducation avec lesquels nous travaillions, pouvaient participer : chacun pouvait apporter sa contribution, de manière à construire, à la fois, un savoir commun et un ensemble de ressources communes. Nous étions impliqués ensemble dans un processus permanent de réflexion, par un système d’échanges réciproques de savoirs comme l’ont théorisé Claire et Marc Hébert-Suffrin, des échanges réciproques de savoirs qui seraient beaucoup plus faciles aujourd’hui grâce au numérique.
Cela a aboutit à la construction de modèles à la fois pertinents sur le plan scientifique et heuristiques pour les praticiens. Car rien n’est plus intéressant que de permettre à différentes expériences, dans des échanges sereins et exigeants à la fois, de comprendre ce qu’elles ont en commun et ce qui fait modèle, ce dont on peut se saisir pour avancer. C’est, à mes yeux, un fonctionnement vraiment coopératif, un fonctionnement structuré de manière inductive, de la même manière que la construction du concept, telle que l’a théorisée Jérôme Bruner et repris, de manière très précise, Britt-Mari Barth [7]. Qu’est-ce qu’un concept, en effet ? C’est ce qui va permettre de penser des réalités apparemment différentes mais dont la « structure » est identique, ce qui va permettre de se détacher des « apparences », comme disait Platon, pour se saisir de la « réalité » des choses. D’une certaine manière, on peut dire que le concept est moins matériel mais plus « réel » que ce que l’on observe dans un premier temps. Si Marx a appelé son livre Le Capital et non pas « le capitalisme » et, a fortiori, « les capitalistes », c’est parce qu’il était bien convaincu que, si l’on supprimait quelques capitalistes, cela ne supprimerait pas le capitalisme. Et ce qu’il a appelé « le capital », c’est ce qui lui apparaissait à la source - le noyau dur, en quelque sorte - de ce système socio-économique : le principe de la plus-value. Remonter au principe pour comprendre ce qui fait système, c’est précisément la démarche inductive, une démarche initiée déjà par Platon, une démarche particulièrement enrichissante dès lors qu’on s’appuie, pour la pratiquer, sur la confrontation des expériences. C’est une démarche où la coopération incarne la recherche de la vérité et permet la construction du « bien commun », une démarche, à la fois épistémologique, pédagogique et politique, au meilleur sens du terme.
Je l’avais vécue avec Henri Desroches... c’était la démarche des groupes de travail mis en place dans le cadre du Diplôme de Hautes Etudes en Pratiques Sociales, le DHEPS ; c’est une démarche que nous avons pu expérimenter à Lyon 2 et qui nous a permis, d’ailleurs, de modéliser un certain nombre de dispositifs pédagogiques comme la « situation problème ». On a collecté des dizaines et des dizaines de situations qui « faisaient problème » pour les élèves, à divers niveaux et dans diverses disciplines, et qui permettaient d’accéder à des savoirs identifiés... et puis on s’est coltiné ensemble à la construction d’un modèle qui pouvait être ressaisi par chacun des participants, mais aussi transféré dans des contextes divers. Chacun a apporté son expérience, l’a confronté à celle des autres, a contribué à la construction de ce modèle et ce modèle a, ensuite, pu être réutilisé par chaque participant, à la fois, pour mieux lire ce qu’il faisait et le communiquer, mais aussi pour échanger avec d’autres et le perfectionner encore. Ce fut un vrai travail collectif qui s’appuyait sur les expériences et l’exigence réciproque des uns envers les autres. Ce fut une authentique « recherche-action » comme nous aurions besoin d’en développer beaucoup dans le champ éducatif et social.
 Coopérations
Coopérations